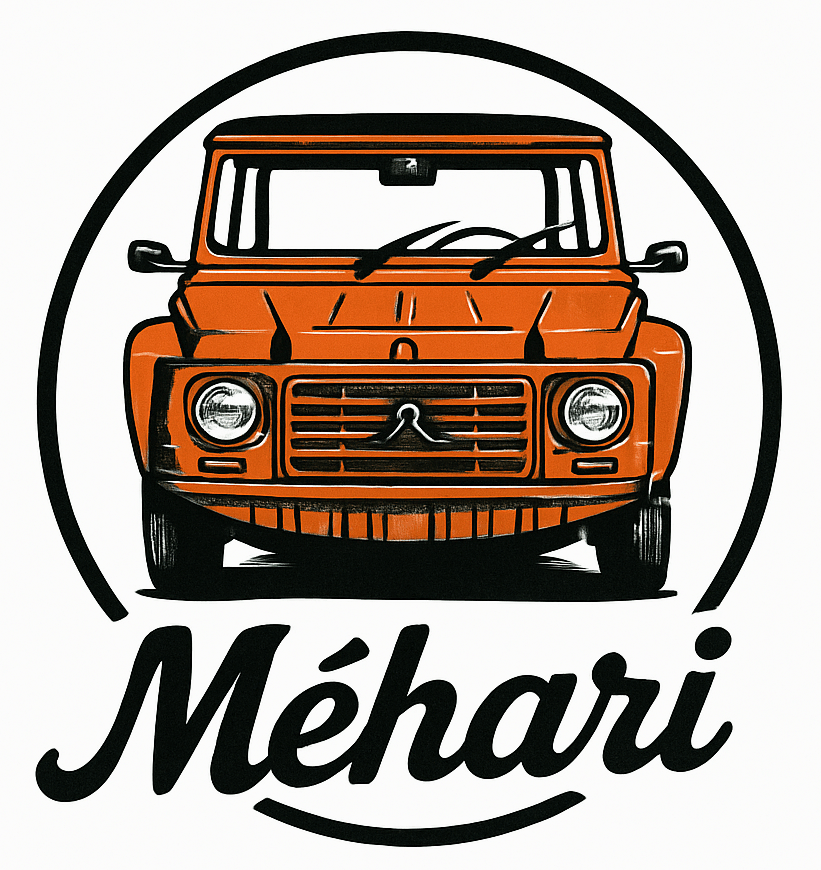L’historique de la Méhari en quelques dates :
• 1967 : Le Comte Roland Paulze d’Ivoy de la Poype, industriel français avide de challenges et de défis (c’est un ancien de l’escadrille Normandie – Niémen et du 602 ème (sic) squadron de la Royal Air Force) , propriétaire de la Société d’Exploitation et d’Application des Brevets (S.E.A.B.), fait la connaissance de Jean-Louis Barrault, designer, et de Jean Darpin.
Ces trois hommes sont à l’origine de la Méhari.
Dans un premier temps, la voiture étant destinée à être commercialisée en kit, elle devait s’adapter sur une base existante pourvue d’un châssis séparé.
Si la Renault 4 fut d’abord envisagée, celle-ci fut rapidement abandonnée, la présence du radiateur à l’avant ne permettant pas d’abaisser suffisamment le nez.
La 2 CV, véhicule léger également conçu sur la base d’un châssis, mais dépourvue de cet accessoire, fut donc assez logiquement désignée.
Sur la base du châssis d’une vieille 2 CV camionnette entièrement débarrassé de sa carrosserie tôlée, mais équipé de sa mécanique d’origine, le comte de la Poype charge J-L. Barrault de dessiner une carrosserie en matériau plastique thermoformé, composée d’une dizaine d’éléments initialement boulonnés sur une armature métallique (cette option fut abandonnée au profit de rivets).
C’est Jean Darpin qui réalisera le montage de ce premier prototype, dont les éléments étaient d’abord réalisés en carton, avant d’en relever les cotes pour réaliser les moules en bois, destinés à la thermoformeuse.
Les premiers essais eurent lieu durant l’été 1967.
Les panneaux de carrosserie, réalisés en ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) présentent, dans un premier temps, un profil lisse qui, manquant de rigidité, sera abandonné dès le second prototype au profit de panneaux nervurés, tels que nous les connaissons encore aujourd’hui.
A l’automne 1967, le premier prototype, encore équipé du moteur de 425 cm³ de 18 ch. de la camionnette, est montré aux techniciens de Citroën dans les locaux de la S.E.A.B., avant son envoi au Quai de Javel pour y être présenté à la Direction Générale de Citroën.
Roland de la Poype, qui avait imaginé commercialiser lui-même son véhicule sous le nom de « Donkey » fit tellement bonne impression que Citroën, en la personne de Pierre Bercot, alors président de la marque aux deux chevrons, décida d’intégrer cet « âne » dans sa gamme utilitaire.
Comme la conception du prototype n’émanait pas du Bureau d’Études, les plans furent établis d’après les pièces « grandeur nature », ce qui est une façon plutôt inhabituelle de travailler.
Le nom de « Méhari », qui signifie dromadaire, fut finalement choisi car il symbolise tout à la fois l’aspect utilitaire et ludique de la voiture, sa sobriété et son endurance.
• 1968 : Les premiers mois de l’année sont mis à profit pour assembler les douze premiers exemplaires de présérie, qui seront les seuls à être réalisés dans les ateliers de la S.E.A.B.
Ils seront équipés du moteur de la Dyane 6 présentée au salon de 1967, et propulsée par le 602 cm³ développant 28 ch. Les huit exemplaires présentés à la presse font partie de ce lot.
Les événements qui occupent la France en ce mois de mai perturberont quelque peu le calendrier prévu. Les voitures de présérie acheminées vers Deauville le seront à la dernière minute, la peinture, différente pour chacune d’entre-elles, à peine sèche.
Ces véhicules de présérie se distinguent de la production définitive par quelques différences :
- Les clignotants avant, rectangulaires, sont placés sous les optiques de
phares. - Les clignotants arrière sont placés entre les petits ailerons latéraux.
- Les feux arrière proviennent d’une 2 CV.
- Les sièges avant, moulés en ABS, ont un dossier réglable commun.
- Les roues sont garnies d’enjoliveurs.
- Un pare-soleil pour le conducteur ainsi qu’un rétroviseur intérieur.
- Une roue de secours placée verticalement à gauche, derrière le
conducteur. - La plaque d’immatriculation arrière est placée sous le hayon.
Le 16 mai 1968 a lieu la présentation officielle de la Méhari à la presse automobile, réunie pour l’occasion sur le golf de Deauville.
Une vingtaine de mannequins de l’agence Catherine-Harlé défilent sur la pelouse du terrain de golf, à bord de huit des douze voitures de présérie. (quatre sont « en réserve »). Huit autres modèles de présérie seront encore assemblés dans les locaux de la S.E.A.B., portant le total des véhicules de présérie à vingt voitures.
Jacques Wolgensinger, directeur des relations publiques et de la communication de Citroën, organisera cette journée comme un grand show médiatique.
Ceci est d’autant plus surprenant que la voiture dépend du département véhicules utilitaires de la marque.
Chaque véhicule, peint dans une teinte couleur différente, présente une utilisation originale de la Méhari, les mannequins étant habillés en rapport avec le sujet.
Les teintes proposées ne seront pas toutes retenues pour le catalogue.
- La jaune pour le golf. Après tout, on est sur le terrain de Deauville.
Sacs et clubs à bord - La bleue, équipée d’un gyrophare, pour les services de sécurité.
Les jeunes femmes sont « armées » et accompagnées de chiens. - La grise, décorée de fleurs, pour les babas cool et les loisirs.
Robes à fleurs, bottes et guitare pour les filles. - La rouge, version pompiers, est équipée d’un gyrophare orange et
d’extincteurs. - La beige, pour aller à la chasse est, elle, équipée d’une plaque de
désensablement et d’une pelle sur le côté gauche. - La verte, chargée de foin, pour la ferme.
- La turquoise, dont les occupantes fort courageuses sont en maillot de
bain pour aller à la plage. Ballons et parasol sont de la partie. - La blanche, enfin, est quant à elle chargée de petites cages contenant
chacune un lapin blanc, qui sera offert à chaque journaliste à la fin
de la journée.
L’appellation commerciale définitive sera « Dyane 6 Méhari » et lors de la commercialisation, au salon de Paris en automne 1968, la puissance du moteur sera portée à 33 ch., tant pour la Dyane que pour la Méhari.
Le véhicule est rattaché à la gamme Dyane, alors qu’il est construit sur base de camionnette AK, et non de Dyane.
Le 8 juillet 1968, la demande d’homologation est introduite auprès du service des Mines, le procès-verbal d’homologation étant, quant à lui, daté du 6 août 1968.
La production peut alors commencer. La société d’Exploitation Nouvelle d’Automobile et de Carrosserie (E.N.A.C.), située à Bezons en région parisienne, déjà chargée par Citroën de la fabrication des 2 CV camionnettes, est désignée pour la mise en production des 2500 premiers exemplaires.
• Octobre 1968 : 55ème Salon de l’Auto, du 3 au 13 octobre, à la porte de Versailles, mais premier salon pour la Dyane 6 Méhari, qui a entre-temps hérité du moteur de 33 ch. de celle qui lui a donné son nom définitif.
La boîte de vitesses, elle, est différente : le couple conique de 8 x 33 de la Dyane est ramené à 8 x 31 sur la Méhari, et les rapports de boîte donnent des vitesses, pour 1000 tr/min., de 4,606 km/h en 1ère et en marche arrière, de 9,022 km/h en 2ème, de 14,493 km/h en 3ème, et de 19,613 km/h en 4ème. (rapports de la camionnette, pneus de 125 x 380, développement au sol de 1,80 m)
Pour des pneus de 135 x 380, avec un développement au sol de 1,842m, les vitesses, pour 1000 tr/min sont respectivement de 4,713 km/h en 1ère et en marche arrière, de 9,232 km/h en 2ème, de 14,831 km/h en 3ème, et de 20,071 km/h en 4ème.
Trois couleurs sont proposées : le rouge Hopi, le beige Kalahari et le vert Montana.
Une seule version de carrosserie : la 4 places, dont la banquette arrière possède un dossier amovible pouvant se rabattre, de manière à former un plancher de chargement rigoureusement plat d’une superficie de 1,6 m².
Cette surface sera largement exploitée par les propriétaires de Méhari, puisque la charge utile est de 400 Kg, pour un poids à vide de 525 Kg.
Par rapport au modèle de présérie, les enjoliveurs de roues et le pare-soleil ont disparu. Les feux arrière sont devenus ronds, et les clignotants avant rectangulaires ont émigré vers les ailes, à hauteur des phares.
Les sièges avant sont totalement indépendants et montés sur glissières.
Il n’y a plus de réglage du dossier.
Des élastiques sont placés de part et d’autre du capot, permettant de solidariser celui-ci avec les ailes.
Une capote intégrale fixée par boutons-pression est proposée, avec des portes amovibles équipées, comme les panneaux latéraux et la face arrière, de baies transparentes en vinyle.
Un pare-brise rabattable est proposé en option.
• Avril 1969 : Une nouvelle capote est proposée avec des fixations par œillets, plus résistants que les boutons-pression.
• Juillet 1969 : Premier grand frisson pour la Méhari.
200 jeunes belges participent au raid Liège – Dakar – Liège, organisé par le Royal Automobile Club junior de Liège.
100 d’entre eux feront le voyage aller, les cent autres assureront le retour à bord de 25 Méhari.
Ils traverseront sept pays, escortés de quatre camions Berliet d’assistance sur les quelque 4000 km du périple.
• 1970 : Quelques modifications sont apportées à la voiture.
Les clignotants avant deviennent ronds et se positionnent sur la face avant légèrement modifiée pour l’occasion, de part et d’autre des optiques de phares. La plaque d’immatriculation avant remonte et se place dorénavant sur le pare-choc.
Des renforts sont placés de part et d’autre du pare-brise.
Les clignotants arrière deviennent ronds et se déplacent sur la face arrière, à côté des feux. Les petits ailerons des ailes seront cependant conservés.
L’immatriculation arrière remonte également et se place sur le hayon.
Une version strictement deux places est inscrite au catalogue afin de permettre aux acheteurs de bénéficier du régime fiscal propre aux utilitaires.
C’est dorénavant la banquette arrière qui devient optionnelle.
L’orange Kirghiz est proposé en complément des 3 teintes déjà inscrites au catalogue.
En option, l’embrayage centrifuge, le lave-glace et l’antivol sont proposés.
Le poids à vide passe à 555 kg.
• 1971 : L’année/modèle 1971 commence en septembre 1970, sans différence notable à l’extérieur.
Une barre de maintien est fixée à la gauche du siège passager, de petits aérateurs ronds apparaissent sur le tableau de bord et un répartiteur de chauffage est monté sous la planche de bord.
Au mois de décembre 1970, les batteurs à inertie du train arrière sont supprimés, la Méhari étant équipée d’amortisseurs hydrauliques dès le début de sa commercialisation.
En janvier 1971 apparaît le témoin de pression d’huile, à droite du compteur, en lieu et place de la grille de passage des vitesses. Celle-ci est dorénavant placée entre le compteur et la jauge de carburant.
Le moteur, quant à lui, se voit équipé d’une cartouche de filtre à huile, placée à droite.
A partir du mois d’avril, l’encadrement de pare-brise sera réalisé en aluminium. Ce dernier peut à présent être rabattu de série, en lieu et place du cadre en tôle, dont les charnières étaient en option.
C’est également en avril qu’apparaît au catalogue l’option « ENAC ».
Il s’agit d’un hard-top complet (toit, hayon, panneaux latéraux et demi- portes avant) en ABS, conçu par la S.E.A.B., teinté dans la masse de la même couleur que la carrosserie, et qui remplace le capotage traditionnel, rendant ainsi la voiture totalement hermétique (sic). Les hauts de portes restent en toile.
• 1972 : Seule option apparue sur ce millésime (septembre 1971), la capote arrière repliable sera très vite retirée du catalogue, suite à des problèmes d’homologation.
Le cardan de direction de l’ami 8 équipe maintenant la Méhari.
C’est en 1972 qu’apparaît le modèle « armée ». Les différents Corps en acquerront environ 8 % de la production totale.
• 1973 : Les normes anti-pollution font leur apparition, et la Méhari n’échappe pas à la règle. Le carburateur Solex 34 PICS 6 dépollué remplace l’ancien modèle 40, et un nouveau filtre à air plus important fait son apparition, ce qui entraîne la modification du profil du capot avant, qui adopte dorénavant un bossage central.
La contenance du réservoir passe de 20 à 25 litres.
• 1974 : Année de production record, avec 13.910 unités produites entre janvier et décembre.
Pas de changement notable cependant.
• 1975 : Ce modèle se distingue par un aménagement différent de la planche de bord et du poste de conduite :
- Nouveaux boutons poussoirs.
- Signal de détresse (à la place de la commande des feux de stationnement).
- Voltmètre thermique.
- Volant de teinte marron.
- Nouvelle tirette de starter.
- Carburateur Solex 34 PCIS 6, repère 164.
• 1976 : Une nouvelle couleur en chasse une autre dans le nuancier du Quai de Javel : Le rouge Hopi se retire et laisse la place au vert Tibesti.
Le train avant reçoit enfin des amortisseurs hydrauliques en lieu et place des antiques frotteurs, ce qui entraîne la disparition, immédiate cette fois, des batteurs à inertie.
Le carburateur Solex 34 PCIS 6, apparu en 1973 et modifié en 1975 (repère 164), évolue encore sur les moteurs à embrayage mécanique, qui se voient dotés du type 34 PCIS 6, repère 175.
C’est en juin que la Méhari sera équipée d’un nouvel antivol de direction, ainsi que de nouvelles serrures sur les demi portes avant.
En juillet le circuit de freinage est dédoublé. Il est désormais constitué de deux réservoirs de liquide hydraulique équipés de sondes et d’un voyant de contrôle du niveau minimum
C’est également au cours de cette année que les accords passés entre Michelin et Peugeot S.A. en 1974 sont finalisés. Citroën quitte le giron du manufacturier de Clermont-Ferrand pour entrer dans celui de la firme de Sochaux. Le groupe P.S.A est créé.
• 1977 : Dès l’arrivée de ce millésime, soit en septembre 1976, la plaque constructeur affiche, à gauche du type, l’année modèle de la voiture.
Le carburateur Solex 34 PICS, repère 193 et 194, du type « inviolable » est dorénavant monté en série. L’accès aux vis de réglage est interdit par de petits capuchons en plastique.
Au mois de mai 1977 la démultiplication de la direction est augmentée et adopte un rapport de 1/17 en lieu et place du rapport 1/14 précédent, ce qui a pour conséquence la réduction du diamètre du volant, qui passe de 43 cm à 39 cm comme sur la 2 CV.
Au mois de juillet, la Méhari, qui jusqu’alors était considérée comme véhicule utilitaire et avait à ce titre échappé aux ceintures de sécurité, se voit rattrapée par la réglementation et dotée de ceintures ventrales aux places avant.
Le système de freinage est également revu. C’est l’Ami 8 qui fournira les freins à disques qui seront désormais montés sur toutes les Méhari.
Ce changement imposera la mise en place d’un nouveau levier de frein à main, ainsi qu’une modification du châssis tubulaire permettant la fixation de la nouvelle platine derrière la boîte de vitesse.
Le liquide de frein synthétique de type Lockheed (rouge) est remplacé par le Liquide Hydraulique Minéral, le LHM (vert).
• 1978 : Le nuancier évolue encore avec l’arrivée du beige Hoggar en lieu et place du beige Kalahari.
Pour ce millésime apparu au mois de septembre 1977 l’esthétique de la face avant est complètement revue.
Les clignotants, devenus rectangulaires, prennent place sous les phares, tandis qu’une grille de calandre démontable est découpée dans la face avant permettant un accès plus aisé (sic !) au boîtier d’allumage.
Le capot prend à nouveau de l’embonpoint afin de laisser de la place au nouveau filtre à air d’origine LN qui coiffe le carburateur double corps de même provenance, ce qui fait passer la puissance de 28 ch. à 33 ch. SAE. (26 à 29 ch. DIN)
Du coup, les chevrons du capot passent de la position horizontale à la position verticale.
L’adoption de ces éléments impose également la modification du pédalier, qui devient suspendu et adopte une commande d’accélérateur par câble.
• 1979 : Avec l’avènement de ce millésime, c’est au tour de l’intérieur de la Méhari de se voir moderniser. C’est encore la LN qui va fournir l’élément principal de ce changement : le compteur. Réalisé entièrement en plastique, il est composé de deux cadrans ronds, abritant à droite le compteur de vitesse et le totalisateur kilométrique, et à gauche, différents témoins (de gauche à droite : charge batterie, feux de route, indicateur de direction, feux de croisement, pression d’huile) ainsi que, au-dessus, la jauge de carburant.
Un nouvel élément thermoformé vient habiller le haut de la colonne de direction, englobant les commandes de phares et de clignoteurs.
A gauche prennent place de nouveaux boutons-poussoirs carrés qui commandent les essuie-glaces, le lave-glace, les feux de détresse et le test du niveau de liquide de frein. (Également appelé « nivocode »).
Au mois d’avril, de nouveaux phares Cibié sont montés, et les enjoliveurs qui les entourent s’arrondissent.
C’est au mois de mai 1979, soit exactement onze ans après la présentation des modèles de présérie sur le golf de Deauville, que Citroën propose (enfin diront certains !) la Méhari en version 4×4. Il s’agit, cette fois, d’une vraie traction intégrale, contrairement à la 2 CV Sahara qui était, elle, équipée de deux moteurs indépendants.
Elle ne sera toutefois commercialisée qu’au début de 1980.
Cependant, dès l’automne 1979, Thierry Sabine et son équipe effectuent les reconnaissances du rallye Paris – Dakar de 1980 à bord de 3 Méhari 4×4 accompagnées par un CX.
• 1980 : La première modification de ce millésime, dès le mois de juillet 1979, est l’apparition du réservoir en plastique en lieu et place de celui en tôle utilisé jusque là.
Nouvelle évolution du nuancier de la Méhari : désormais le jaune Atacama remplace l’éphémère vert Tibesti qui ne sera resté que quatre ans au catalogue.
En février, le réservoir de liquide de frein et que le maître-cylindre se voient équiper d’un filtre.
• 1981 : La plaque constructeur évolue à nouveau et sera désormais fixée par 4 rivets au lieu de deux. Le millésime, apparu en 1977 en haut à gauche de celle-ci, disparaît.
Le numéro de châssis, qui auparavant se situait sur la plate-forme et était invisible une fois la carrosserie montée, sera dorénavant frappé sur le longeron avant droit, et visible entre le cylindre et l’arbre de transmission.
Les clients ayant opté pour l’option « capote intégrale » voient celle-ci complétée par une astucieuse poche « kangourou » fixée sous le dais arrière qui leur permet de ranger les hauts de portes.
• 1982 : Au mois de juillet 1981 une nouvelle mouture de la plaque constructeur est adoptée. Non seulement l’aspect change, mais dorénavant elle sera fixée dans l’habitacle, sous le tableau de bord, à l’extrême droite côté passager.
Au mois de février, l’embrayage à linguets est remplacé par un nouveau modèle à diaphragme. Ceci entraîne l’allongement des cannelures de l’arbre primaire, qui passent de 27mm à 36 mm.
• 1983 : Le glas sonne pour la Méhari 4×4 ; au mois de juin 1983 elle sera retirée du catalogue, après une production totale de 1.213 exemplaires (seulement !) pour 143.740 en 4×2.
Elle laissera en héritage à sa sœur de production les panneaux latéraux dépourvus des petits ailerons arrières qui protégeaient les clignotants sur les modèles produits jusqu’en 1969 et conservés depuis malgré leur obsolescence.
Afin de liquider des stocks, Citroën équipe certains modèles 4×2 de panneaux latéraux de capotes de 4×4, reconnaissables à la découpe permettant l’accès au conduit de remplissage du réservoir de carburant spécifique de ces modèles.
Un nouveau monogramme apparaît sur la hayon et les ceintures sont désormais identiques à celles qui équipent la Dyane.
La série spéciale « Azur », limitée à 700 exemplaires destinés à la France, l’Italie et le Portugal, voit le jour au mois d’avril 1983.
Elle se caractérise par sa décoration spécifique : carrosserie blanche, portes bleues, filets bleus de part et d’autre du capot, sièges recouverts de tissus éponge rayé bleu et blanc et roues ajourées.
La capote est également spécifique : de couleur bleue, elle est articulée dans sa partie arrière et peut s’ouvrir au dessus des places avant de la même manière que celle des 2 CV club.
Le succès sera au rendez-vous et la série limitée intègrera le catalogue pour les millésimes 1986 et 1987.
• 1984 : Pas de changement visible pour ce millésime. Seul le pare-brise, réalisé jusque là en verre trempé sera désormais proposé en verre feuilleté.
• 1985 : Rien à signaler pour ce millésime. Le Quai de Javel préconise de porter dorénavant l’intervalle entre les vidanges de 7.500 km à 10.000 km tandis que celui qui sépare les entretiens passe de 15.000 km à 20.000 km (sic ! ).
L’expérience des amateurs de bicylindres démontrera que ces valeurs étaient quelque peu « optimistes ».
• 1986 : La Méhari Azur entre au catalogue. Elle est proposée en version 2 ou 4 places, équipée de son capotage spécifique complet, contrairement au modèle « de base » pour lequel les éléments latéraux et arrière restent une option. Son prix de 51.400 FF est très attractif comparé au 46.700 FF demandés pour une version de base, auxquels doivent être ajoutés 2.960 FF pour l’option « capote complète », ce qui porte la facture à 49.660 FF.
• 1987 : Ultime millésime pour la Méhari. Le modèle de base n’est plus proposé qu’en version 2 places, alors que la version Azur reste proposée dans les deux configurations.
381 exemplaires seront assemblés pour cet ultime millésime, toutes versions confondues.
L’usine portugaise de Mangualde, dernier site de production de la Méhari, arrêtera définitivement les chaînes au mois de juillet 1987, après 143.740 exemplaires en 4×2 et 1.213 en 4×4.